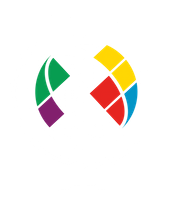Janine Somerville est une mémoire vivante du protestantisme haïtien. De sa jeunesse en Haïti dans les années 1950, elle conserve des souvenirs précis, à partir du milieu baptiste où elle a grandi. Un regard sans nostalgie, tourné vers des projets d’avenir.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis née Janine Paultre, j’ai grandi dans une famille pastorale. J’ai passé toute ma jeunesse en Haïti, jusqu’en 1957. J’ai ensuite poursuivi des études de médecine à Paris. C’est là que j’ai rencontré mon mari, Edouard Somerville, pasteur et missionnaire. Nous avons ensuite été missionnaires au Nord Cameroun de 1960 à 1966, avant de diriger le Foyer de Trémel, en Bretagne. Après 1974, suite aux mutations de mon mari (Aumônerie aux armées), j’ai travaillé dans différents secteurs de l’inadaptation sociale. Depuis 1998, date de ma retraite, je me suis engagée dans une action éducative et sociale à l’Anse Pirogue, en Haïti, où j’effectue un ou deux séjours annuels.
Quels échos retenez-vous de votre jeunesse protestante haïtienne ?
Je voudrais nuancer un peu l’image d’une identité haïtienne d’après-guerre exclusivement centrée sur le couple catholicisme-vaudou. Dès ma jeunesse, jusqu’en 1957, j’ai personnellement connu en Haïti plusieurs Églises protestantes très actives, dont les origines remontaient au XIXe siècle. Elles n’ont certes pas du tout le poids de l’Église catholique, mais attirent du monde. Je pense à l’Église baptiste de Port-au-Prince (pasteur Ruben Marc), où j’ai été baptisée, l’Église wesleyenne (méthodiste), qu’une partie de ma famille fréquentait, et l’Église anglicane (père Gilles). Par ailleurs, à Saint-Marc, une Église baptiste très active gérait une école primaire privée. Mon père, Hector Paultre, en était pasteur, et avant lui, mon grand-père, Orius Paultre. Je me souviens aussi dans les années 1950s d’une station missionnaire mise en place à la Pointe-Palmiste par l’UFM (Unevangelized Field Mission).
À l’époque, le culte était sobre, très recueilli. Rien à voir avec les manifestations de possession des cultes vaudou. L’influence américaine me semblait aussi plus réduite. Ces cultes des années 1950 oscillaient entre recueillement, sobriété, et pointe d’humour. Au temple baptiste de Saint-Marc, les femmes étaient assises, couvertes (chapeau ou foulard), d’un côté de l’allée centrale et les hommes de l’autre. Un dimanche, en arrivant au temple, je vois un couple, bras dessus, bras dessous s’approcher de l’entrée. La femme retire le chapeau de son mari et se le met sur la tête. A la sortie du culte, elle fera le geste inverse…
Le faste des baptêmes
Je garde un souvenir particulier aussi du faste du déroulement des baptêmes, qui avaient un impact important sur le quartier. Du temple, sortait une procession d’hommes et de femmes, vêtus de blanc, sur deux rangs, suivis par toute l’assemblée. Lentement et en chantant, le groupe se dirigeait vers la mer (à deux pâtés de maisons environ), où avaient lieu les baptêmes. La foule, massée sur la plage, accompagnait chacun des baptêmes de cantiques. La cérémonie durait un certain temps, les baptisés regroupant ceux de l’Église-mère et ceux, nombreux, des régions « annexes ». En sortant de l’eau, les baptisés se rendaient dans la cour de mes grands-parents, située en bordure de la mer (où deux tentes étaient dressées, pour la circonstance). Le temps de se rhabiller et toute l’assemblée repartait en direction du temple, pour un culte spécial.
Vous vous occupez en Haïti d’une association nommée l’Essor de l’Anse Pirogue. Pouvez-vous nous la décrire ?
Il s’agit d’un travail social dans un petit village côtier, initié par mes sœurs aînées (nous étions six filles, au sein d’une fratrie de douze) au début des années 1990, puis officialisé dans le cadre d’une association à caractère non lucratif (type « loi 1901 » en France) en janvier 1999. Notre objectif est pragmatique : il s’agit d’améliorer la qualité de vie, motivé par l’amour chrétien. Nous développons trois axes: l’enseignement et l’éducation des enfants (avec l’école Nora Paultre), l’amélioration des conditions d’hygiène et de santé, le relogement des familles dans des habitations de meilleure qualité.
Un de mes beaux-frères, Fritz Fontus, pasteur, a contribué, jusqu’à son décès en 2011, à consolider la petite communauté chrétienne locale de l’Anse Pirogue, par un travail pastoral d’accompagnement et de formation des prédicateurs. Nous souhaitons voir aboutir ce travail par la reconnaissance d’une Eglise constituée, reconnue par le ministère des Cultes d’Haïti, puis son affiliation à la Fédération Protestante d’Haïti.
Quelle part occupent langues française et créole ?
À l’Eglise baptiste de Port-au-Prince (Église-mère), dans mon enfance, il y avait trois cultes le dimanche. Un premier à 6h00, à l’intention des personnes travaillant dans la journée. Un second à 9h00, à la fin de l’école du dimanche, ce qui nous permettait de participer aux deux moments de cette matinée. Tout se passait en français : cantiques (recueil Sur les ailes de la foi), accompagnement à l’orgue (répertoire : musique classique), lecture alternative d’un psaume, le rappel des Béatitudes, prières, prédication… Trois chorales (Jeunes / Femmes / Hommes) animaient, à tour de rôle, les cultes et offraient, chaque année, un « Concert spirituel », où les trois étaient présentes. Un 3è culte avait lieu dans l’après-midi. Le français et le créole étaient parlés à l’église. Dans les annexes, le culte se déroulait en créole. Pour les cantiques, le recueil Chants d’espérance, comportant une partie en français et une partie en créole, était utilisé.
Dans le petit village de l’Anse Pirogue, le français n’est compris que par les jeunes (scolarisés), si bien que les cultes et réunions de prière se font en créole. On chante aussi bien en français qu’en créole (Chants d’espérance). A noter que le « Notre père » est dit en français. Parfois une ou l’autre personne chante un solo. Le créole domine, mais le français s’entend aussi.